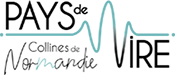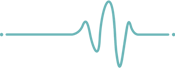À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, cet article met en lumière des figures féminines qui ont marqué l’histoire de Vire. Elles ont œuvré pour la liberté, la reconstruction et la solidarité. De Louise Legrand à Madeleine Herbert Lacroix, Juste parmi les Nations, en passant par Hélène Couppey et les Américaines Anne Morgan, Eva Dahlgren et Ann Arnot Wickes, ces femmes ont façonné l’histoire du territoire. Découvrez leurs parcours inspirants.
Hélène Couppey : une femme engagée au service de Vire
Née le 25 décembre 1902 à Vire, Hélène Couppey, née Marie, grandit dans un environnement tourné vers le savoir, son père étant instituteur. Après avoir suivi sa scolarité à l’école du Haut Chemin et à l’école primaire supérieure de Vire, elle poursuit ses études à Caen puis à Versailles, préparant l’École normale supérieure en section lettres. Un séjour en Angleterre l’oriente un temps vers l’enseignement de l’anglais, mais sa véritable passion la rattrape : la musique. Très jeune, elle a appris à jouer du violon et surtout du piano. Elle est devenue l’élève du virtuose Robert Casadesus.
En 1928, elle épouse le docteur Marcel Couppey, avec qui elle aura trois enfants. Mais au-delà de sa vie de famille, elle s’investit pleinement dans la vie publique de Vire. Présidente de l’Association syndicale de reconstruction de 1952 à 1964, elle joue un rôle clé dans la renaissance de la ville après la guerre, veillant à la reconstruction des quartiers sinistrés et à l’attribution des permis de construire. Son engagement social est tout aussi fort : en 1954, elle prend la tête du Centre social franco-américain de Vire, œuvrant pour l’éducation, l’aide aux jeunes et aux personnes âgées. Élue conseillère municipale de 1959 à 1971, elle devient une figure incontournable du Conseil, écoutée et respectée.
Hélène Couppey reste une amoureuse de la musique. Pianiste accomplie, elle dirige la chorale Olivier Basselin pendant plus de 30 ans, de 1946 à 1977. Ses engagements lui valent d’être distinguée chevalier des Palmes académiques et officier de l’Ordre national du Mérite. Elle s’éteint le 18 février 1977 à Caen, laissant une empreinte indélébile dans l’histoire de Vire. Un square et une impasse portent son nom, en souvenir d’une femme d’exception, à la fois engagée et passionnée.
Madeleine Herbert Lacroix : une Juste parmi les Nations, héroïne discrète de Vire
Née le 10 mars 1911, Madeleine Herbert Lacroix a accompli un acte de courage qui lui vaudra, bien des années plus tard, la plus haute distinction civile de l’État d’Israël. En octobre 2011, à l’âge de 100 ans, elle reçoit, en tant que Juste parmi les Nations, une médaille avec cette phrase du Talmud : « Quiconque sauve une vie sauve l’univers tout entier ».
Vendeuse à la boutique « Au Chic de Paris » à Vire, elle travaille pour Bernard et Régine Goldnadel, un couple juif d’origine polonaise. Dès 1940, leur commerce est confisqué par le régime de Vichy, et Bernard doit fuir vers Paris le 6 février 1941, laissant son épouse et leur fils Jacques à Vire. De santé fragile, Bernard sera accepté dans un sanatorium à Dreux où il séjournera jusqu’à la Libération. En juillet 1942, les rafles s’intensifient. Les gendarmes et la Gestapo se présentent au domicile de Régine pour l’interroger et tenter d’obtenir des informations sur son mari. C’est alors que Madeleine intervient, elle fait la valise de Jacques âgé de 8 ans et demi et l’emmène avec elle. Après son arrestation, Régine sera transférée au camp d’internement de Pithiviers, le 17 juillet, puis déportée sans retour, le 3 août 1942.
D’abord caché chez la sœur de Madeleine, Léontine Papillon, dans l’Orne, Jacques y restera deux ans. Mais en 1944, une dénonciation met en péril son refuge. Madeleine revient alors le chercher et le conduit jusqu’à Guéret, en zone sud, prenant d’énormes risques en le faisant passer pour son propre fils lors des contrôles dans le train. Grâce à elle, Jacques échappe à la déportation.
Après la guerre, Bernard Goldnadel revient à Vire et rouvre son magasin. Des décennies plus tard, la fille de Madeleine entreprend de retrouver « le petit Jacques » dont sa mère parlait si souvent, à l’occasion de ses 100 ans. Lorsque Jacques apprend qu’elle est encore en vie, il écrit immédiatement à l’Institut Yad Vashem pour que Madeleine soit honorée. En 2011, il assiste à la cérémonie qui reconnaît officiellement son courage.
Après son décès, un hommage lui est rendu en Israël, en présence de représentants de plusieurs communes. À Vire, son nom est désormais gravé dans la mémoire collective : en 2018, le pôle santé de la ville est baptisé « Madeleine Herbert, Juste parmi les Nations », et une plaque rappelle son héroïsme.
Louise Legrand : une résistante silencieuse, marquée par la déportation
Née le 14 mai 1890 à Saint-Germain-de-Tallevende, Louise Legrand grandit dans un milieu modeste, son père étant charron et sa mère occupée au ménage. Couturière passionnée de broderie, elle s’installe à Vire avec sa sœur Léa, au 10 rue du Bourgneuf, dans le quartier Sainte-Anne.
Pendant l’Occupation, son destin bascule. Le 11 février 1943, sur dénonciation, la Feldgendarmerie perquisitionne son domicile et y découvre un fusil de guerre et des munitions. Fidèle à ses valeurs, Louise refuse de révéler qui a déposé l’arme. Arrêtée, elle est incarcérée à Caen, puis à Fresnes, avant d’être déportée en Allemagne le 29 avril 1943. Elle séjourne dans plusieurs prisons, de Aachen à Flussbach, en passant par Breslau, Jauer et Aichach, près de Munich. Marquée du sigle « NN » (Nacht und Nebel, « Nuit et Brouillard »), elle ne porte pas de matricule comme les autres déportés mais un brassard, signe de son statut particulier destiné à la faire disparaître dans l’anonymat le plus total.
Libérée le 29 avril 1945 par les troupes américaines, elle est envoyée en sanatorium en Forêt-Noire pour soigner la tuberculose contractée en captivité. Son corps est affaibli : elle a perdu 16 kilos et souffre de séquelles physiques irréversibles. De retour à Vire en octobre 1945, elle découvre une ville en ruines et sa maison détruite par les bombardements. Elle trouve refuge dans un baraquement place du Château-de-Bas et reprend le travail en février 1946 comme lingère à l’hôpital de Vire. De plus, elle devra se battre des années pour obtenir une pension d’invalidité.
Discrète et effacée, Louise Legrand ne parle que rarement de sa déportation, contrairement à d’autres résistantes viroises comme Jenny Peyet et Louise Mahy, qui ont témoigné. Lorsqu’elle s’éteint le 28 décembre 1965, son cortège funéraire est marqué par un geste symbolique : Jenny Peyet, elle-même ancienne déportée, tient l’un des coins du drap mortuaire.
Ce n’est que bien plus tard que la vérité éclate : l’arme trouvée chez elle appartenait à son neveu, Albert Fautré, arrêté puis déporté. Il ne reviendra jamais, perdant la vie dans un camp le 6 juin 1944. Louise Legrand, elle, restera à jamais une figure méconnue mais exemplaire de la résistance silencieuse.
Ann Arnot Wickes, la reporter américaine qui a immortalisé la reconstruction de Vire
Le Musée de Vire Normandie met en lumière des femmes américaines qui ont marqué l’histoire locale. Parmi elles, Ann Arnot Wickes, une jeune photographe missionnée par le Comité Américain de Secours Civil (CASC) en 1948.
Grâce aux recherches de sa fille, Anita Brewer-Silijehølm, qui vit aujourd’hui près de Boston, 484 clichés inédits sont visibles au musée. Ces photographies, prises durant l’été 1948, témoignent du travail du CASC à Vire après les bombardements du 6 juin 1944. Du 24 au 26 juin, Ann Arnot Wickes a immortalisé les actions menées : distribution de produits de première nécessité, accueil des enfants, enseignement ménager, camps de vacances et aide aux personnes âgées. Ses images, d’une valeur documentaire exceptionnelle, offrent un regard sensible sur la vie des sinistrés et rappellent le style humaniste de Robert Doisneau ou Willy Ronis.

Portrait d’Ann Arnot Wickes, en 1948, don d’Anita Brewer-Silijeholm en 2014 ©Musée de Vire Normandie
Anne Morgan et Eva Dahlgren, des mécènes engagées
L’histoire du CASC à Vire est aussi marquée par des figures féminines d’exception. Anne Morgan, héritière du puissant banquier J.P. Morgan, a consacré sa fortune et son énergie à aider les populations françaises frappées par les deux guerres mondiales. En 1946, à 73 ans, elle effectue sa dernière visite en France, notamment au centre virois, dirigé par Eva Dahlgren.

Le drapeau américain se lève sur Vire. Camp d’été pour les jeunes du CASC, juin 1948, photo d’Ann Arnot Wickes
©Musée de Vire Normandie
Eva Drexel Dahlgren, membre du CASC, arrive en France en 1940. Résistante à Lyon, elle est arrêtée par les Allemands en novembre 1942 et emprisonnée jusqu’à un échange de prisonniers en février 1944. De retour aux États-Unis, elle aurait pu y rester, mais choisit de revenir clandestinement en France après la Libération pour diriger le centre d’aide virois. C’est elle qui convainc Anne Morgan d’implanter le CASC à Vire, décrivant des conditions de vie précaires :
« 1 500 maisons ont été détruites, sans doute par des bombardiers américains, et il n’en reste plus que 100 encore debout pour loger la population. Les conditions de vie sont toujours épouvantables : plusieurs personnes entassées dans une seule pièce, ni chauffage, ni eau courante, et guère de possibilités pour cuisiner. »
En 1947, Eva Dahlgren prend la direction générale du CASC en France, laissant la gestion du centre virois à Miss Frances Eddy, originaire du Massachusetts et diplômée de Mount Holyoke. Son engagement indéfectible et son énergie laissent un souvenir impérissable aux enfants de l’époque, aujourd’hui émus de se reconnaître sur les clichés d’Ann Arnot Wickes.

Miss Frances Eddy photographiée par Ann Arnot Wickes ©Musée de Vire Normandie
Un immense merci à Marie-Jeanne Villeroy, conservatrice du Musée de Vire Normandie, ainsi qu’à Guy Chevereau et Pascal Simonin, membres de l’AVPPS (Association de valorisation du patrimoine en Pays séverin), pour leurs précieuses recherches sur ces femmes qui ont marqué l’histoire du Bocage.