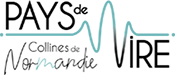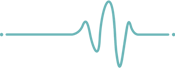Matthieu, notre guide conférencier, vous raconte 3 histoires avec un point commun, elles se sont déroulées en janvier.
Pourquoi l’année commence le 1er janvier ?
En 1564, le roi de France, Charles IX, prend une décision étrange : il décide de faire commencer la nouvelle année le 1er janvier. Cette année-là, sa mère, Catherine de Médicis, la régente, lui organise un tour de France. Il n’a alors que 14 ans. L’objectif est de le faire rencontrer ses sujets et de réconcilier un royaume scindé en deux parties : catholiques et protestants. Le périple dure 27 mois et s’étend sur 4 000 kilomètres. C’est le voyage le plus long et le plus important effectué par un roi de France. Mais il ne voyage jamais seul, il est d’ailleurs bien entouré ! Imaginez une suite d’environ 10 000 personnes se déplacer sur les petites routes de France : ambassadeurs, courtisans, soldats, domestiques, artisans, religieux. C’est une ville qui se déplace ainsi que tous les meubles du roi : tapisseries, coffres, tentes, cuisines… Avant l’installation de la cour de Louis XIV à Versailles, les souverains étaient itinérants. Durant ce périple, le roi s’aperçoit que le calendrier n’est pas le même selon les régions ou diocèses. À certains endroits, la nouvelle année commence le 25 décembre, jour de la Nativité. Dans d’autres, c’est le 1er mars ou le dimanche de Pâques. Au mois d’août 1564, alors qu’il est dans la ville de Roussillon en Isère, Charles IX décide de faire commencer l’année le 1er janvier. L’édit de Roussillon voit le jour. La mesure sera effective à partir du 1er janvier 1567. L’année 1566 ne dura que 8 mois et demi, du 14 avril au 31 décembre. Cette décision aura un impact énorme puisqu’elle est validée par le Pape qui décide de l’appliquer à toute l’Europe chrétienne.

Les mésaventures de François 1er avec une bûche enflammée
Au début de l’année 1521, le roi François Ier est au château de Romorantin avec sa cour. Romorantin est une petite ville située à quelques kilomètres au sud du château de Chambord, alors en construction. Le 6 janvier, jour des Rois, après le déjeuner, le souverain décide avec son entourage de rejoindre le bourg recouvert de neige où se trouve l’hôtel particulier d’un courtisan pour jouer à un jeu qui va vite tourner à la catastrophe. Ils font deux équipes, la première s’installe dans la maison et la seconde doit assiéger la demeure et s’en emparer. Le roi fait partie de l’équipe placée à l’extérieur. S’engage alors une bataille assez violente. François Ier qui mesure 1m98 (un géant pour l’époque), peut-être un peu alcoolisé, essaie de défoncer la porte de la maison. Un courtisan de l’équipe adverse ouvre la fenêtre du premier étage et lance une buche enflammée sur sa tête. Le roi tombe dans le coma. Tout le monde s’affole, les médecins font ce qu’ils peuvent mais il ne reprend pas conscience. Ce n’est qu’en fin de journée qu’il revient à la vie. Une fois réveillé, on lui rase la tête pour soigner la plaie. Le serviteur ne sera pas sanctionné car c’était un jeu, en revanche le roi n’appréciant pas d’avoir la tête rasée va imposer à ses courtisans la même coupe de cheveux. Quelques mois plus tard, François Ier décide de laisser pousser la barbe pour cacher les cicatrices qu’il a au visage. Les hommes de la cour feront alors la même chose, la mode de la barbe restera pendant un siècle.
Fun fact : tel père tel fils
Le lanceur de buche n’est autre que Jacques Ier de Montgomery, son fils Gabriel de Montgommery tuera malencontreusement le roi Henri II lors d’un tournoi 38 ans plus tard.
Le Grand Hiver 1709
Entre 1350 et 1850, l’Europe a connu ce que les historiens appellent « Le petit âge glaciaire ». C’est la période la plus froide au cours des 10 000 dernières années. Les causes sont multiples et complexes : réduction de l’activité solaire, une activité volcanique importante, les cendres émises réfléchissent les rayonnements solaires et un ralentissement du Gulf Stream, un courant océanique qui apporte des vents chauds. Un pic de froid est atteint au temps du roi Louis XIV. L’hiver 1708-1709 reste le plus redoutable de la période. Le Noël 1708 est particulièrement doux, il fait 10 degrés le 5 janvier. Dans la nuit du 6 janvier, le froid arrive brutalement, un médecin de Paris, Louis Morin enregistre -8° et ce n’est que le début. Le 13 janvier, il note -18°. Le 25 janvier le thermomètre remonte et l’eau s’accumule en surface. Mais début février, le froid revient violemment et les températures négatives restent jusqu’à fin mars. Les rivières sont gelées, les arbres éclatent, toutes les récoltes sont mortes et irrécupérables : la vigne, les oliviers dans le sud. Le froid et la famine provoquent des milliers de morts. Au début du printemps, après le dégel, les paysans s’activent à semer ce qui est encore possible, c’est la ruée vers l’orge ! Coup de chance, le printemps est humide et le gel a débarrassé la terre des mauvaises herbes. La récolte est très bonne, voire même exceptionnelle à certains endroits. Pendant un an, les français mangèrent du pain d’orge. Ce n’est pas ce qu’il y a de meilleur, mais cela sauva de nombreuses vies.